 Visite d’un camp d’occupation
Visite d’un camp d’occupation
Nous sommes à Campina Grande, la ville des paysans, comme disent les gens de Joao Pessao. Il y a là un stade, architecture plutôt moderne. A ses pieds, un terrain vague, qui a été occupé il y a quelques années par 47 familles, probablement les familles les plus en difficulté de la ville. A comparer, les favelas, c’est l’hôtel trois étoiles, voire trois et demi. Ici, une série de cabanes, faites de bric et de broc, un peu comme celles que l’on a vu dans les acampamentos : du bois, des bâches, du cartons, trois tôles. La différence ? Au lieu des jardins, des tas de poubelles.
Il y a des gosses partout, des tous petits, des moyens, des grands, et des grands qui ont déjà des petits, du genre j’ai seize ans et trois enfants ! Tout de suite, on nous agrippe le pantalon. « Tu peux me donner un réal ? », « Hé, tu peux me donner un réal ? », « Dis, tu peux me donner un réal ? ». Je ne comprends pas le portugais, mais je sais que c’est ça qu’on me demande. Quoi répondre ? Que je ne comprends pas la langue du pays ? Faux jeton ! Je ne suis juste pas très à l’aise.
Il y a aussi des adultes, bien sûr. Des femmes, et des grand-mères, qui s’occupent de leurs petits enfants. Les hommes sont surement au boulot, à trier les poubelles, les autres sont en prison, parait-il, pour des vols, ou des crimes. Voler, ou tuer, mais survivre !
Il y a l’électricité sur le camp, on se débrouille pour se raccorder à un poteau électrique. Il y a l’eau courante aussi, des copains plombiers arrivent à créer des dérivations sur les réseaux d’eau, publics ou privés. L’administration ou les entreprises ferment les yeux, on ne peut quand même pas finir d’enterrer ceux qui sont déjà au fond du trou. Dans les acampamentos, on peut toujours faire un peu de jardin pour manger, et il y a les copains des assentamentos qui amènent des légumes. Mais ici, on bouffe aux poubelles, on ne peut compter que sur les rejets des autres, et encore, il faut trier. Ca fait une belle différence.
Le MNLM-PB devrait pouvoir reloger ces familles, si tout va bien, dans six mois ou dans un an. Il y a un programme de construction dans la ville qui a été interrompu pour corruption, mais qui semble gentiment se débloquer. Ceci dit, tant qu’on est sûr de rien, on n’évoque pas le sujet, il serait assez mal venu de donner de faux espoirs.
Une femme nous parle des conditions de vie sur le campement. « Le principal, c’est la santé », dit-elle, « le reste, ça n’est que du matériel ». Une autre essaie la conversation avec Marie-Anne. Elle ne lui demande pas le moindre Réal, simplement de lui envoyer de la force et du courage depuis la France, et de prier, pour elle et ses camarades.
Gorge serrée, c’est le choc, un peu à retardement. Besoin d’un paquet de kleenex, besoin de déguerpir d’ici, besoin de respirer, besoin de comprendre comment on peut en arriver là, alors que d’autres se gavent à en vomir. On connaît tout ça, bien sûr, les mêmes images, vues à la télé ou dans les revues. Mais là, il n’y a pas d’écran, c’est du direct. On monte dans le bus. On part. On n’en mène pas large. Silence radio pour la suite du trajet.
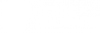


Commentaires
1. Le Dimanche 10 juillet 2011, 09:28 par Chantal
Immersion ? Plongée dans ce qui est, avec ce qui se vit là-bas.
Immersion ? Enlever le paravent des écrans
Immersion ? Toucher des yeux, sentir son coeur se serrer
Immersion ? Ramener des images des rencontres
Immersion ? Rien ne sera plus comme avant.
Malgré la dureté de ces vies, des sourires, des mains, des regards qui fleurissent çà et là...
Bises à tous
Chantal
2. Le Dimanche 10 juillet 2011, 22:38 par Liliane
Bonjour à tous,
On vous suit "à distance" C'est intéressant.
Votre compte rendu de vendredi "ébranle"
Remarquables sont la force et l'espérance de cette femme.
Bonne continuation.
A bientôt
Liliane du 90
3. Le Lundi 11 juillet 2011, 18:51 par Marie-Denise
Bonjour a tous et bise a Daniel (Camus),
Merci de nous faire part de vos experiences et temoignages. Quel ecart entre nos deux mondes! C'est boulversant. On vous souhaite beaucoup de courage dans tous ces moments eprouvants. On pense bien a vous. On vous embrasse tous.
Marie-Denise Camus
De Lorient